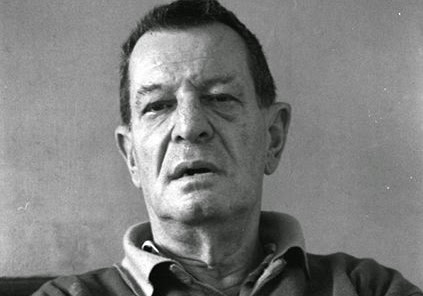samedi 25 avril 2009
Budaï
« En y repensant, ce qui a dû se passer, c’est que dans la cohue de la correspondance, Budaï s’est trompé de sortie, il est probablement monté dans un avion pour une autre destination et les employés de l’aéroport n’ont pas remarqué l’erreur. »
Ferenc Karinthy, Épépé (1970), incipit
traduit du hongrois par Judith et Pierre Karinthy
Budaï est un linguiste. Il se rendait à Helsinki pour y participer à un congrès. Or voilà qu’il se retrouve dans une ville inconnue, qu’on le transporte dans un hôtel où on lui confisque son passeport et que toute sa science ne lui permet pas d’identifier la langue qu’on parle autour de lui. Il en maîtrise pourtant une quinzaine, connaît les rudiments de quinze autres, mais rien à faire, il ne saurait même pas transcrire phonétiquement ce qu’il entend. Quant à l'écriture qui a cours ici, aucun moyen de déterminer si elle est basée sur un alphabet, un système syllabique, des idéogrammes, il a beau l'étudier, si seulement il pouvait la comparer à quelque chose... À cette impossiblité absolue de communiquer s’ajoutent très vite d’autres soucis. Se nourrir, par exemple. Pour la moindre chose, il faut faire la queue pendant des heures, tant la ville grouille, cohue permanente, embouteillages continuels, ce savant timide et poli devra apprendre à jouer des coudes, à rendre les coups. Partout, il est en butte à l’indifférence ou à l’hostilité ; la seule personne qu’il parvient à intéresser à son cas, c’est la blonde liftière de l’ascenseur de son hôtel ― il n’y a pas d’escalier ―, qui s’appellerait Dédé, ou Bébé, ou Vévé, ou encore Épépé, les gens d’ici ont une façon si bizarre d’articuler... Il rédige une pancarte en plusieurs exemplaires, en six langues ; il l’affiche en plusieurs points de l’hôtel, dans les couloirs, dans l’ascenseur, dans le hall et même à l’entrée principale, demandant à quiconque la comprendrait de prendre contact avec lui, chambre 921, ou en cas d’absence de lui laisser un message dans sa case contre une importante récompense. Puis il va frapper aux portes voisines ; le plus souvent il n’obtient pas de réponse, peut-être n’a-t-il pas trouvé le moment adéquat, les habitants ne se trouvent pas dans leur chambre, ou encore c’est lui qui frappe beaucoup trop discrètement.
Et ce n’est que le début de ses ennuis... Il faut plus que du talent, plus qu’un style simple et précis, vif et neutre, plus qu’une imagination inépuisable mais domptée pour tenir sans un seul moment de faiblesse un roman de 250 fortes pages sur ce postulat délirant, pour éviter l’écueil énorme de la parabole-kafkaïenne-un-peu-lourde, genre balisé. De l’inconscience, peut-être, ou du génie. Sachant que j’ai achevé la lecture hallucinée et fébrile de ses pitoyables et trop crédibles aventures hier matin, on me pardonnera mon enthousiasme ; mais Budaï est venu, aussitôt que j’ai fermé le livre, se ranger dans mon esprit aux côtés de K., d’Ulysse, de Malone, de Bardamu, de tous ces sombres héros de l’humaine condition. Ferenc Karinthy, nous apprend la quatrième, “ fut à la fois journaliste, dramaturge, romancier et champion de water-polo” ; son père, Frigyes Karinthy, écrivain et humoriste célèbre en Hongrie, inventeur en 1929 de la théorie des “six degrés de séparation”, avait pour devise : “En humour, je n’admets pas la plaisanterie”. Le mystère s’épaissit.
lundi 20 avril 2009
Broderies anciennes
CHAPITRE VII
M. Wild se lance dans ses voyages et rentre dans son pays. Chapitre fort bref, contenant plus de temps et moins de matière que tout autre du présent récit.
Nous regrettons de ne pouvoir satisfaire la curiosité du lecteur en lui donnant un récit complet et parfait de cet accident. Mais vu le grand nombre et la diversité des comptes rendus, dont un seul, et encore, peut être véridique, au lieu de suivre la méthode habituelle des historiens, qui, en pareil cas, exposent les différentes versions et nous laissent le soin de conjecturer laquelle il y a lieu de choisir, nous les passerons toutes sous silence. Il est certain, en tout cas, que, quel que fut cet accident, il détermina le père de notre héros à envoyer immédiatement son fils à l’étranger pour sept années, et, ce qui pourra paraître assez remarquable, aux plantations de Sa Majesté en Amérique ― cette partie du monde étant, disait-il, plus exempte de vices que les cours et les villes d’Europe et risquant moins, par conséquent, de corrompre les mœurs d’un jeune homme. Quant aux avantages, le père pensait qu’ils y étaient égaux à ceux que l’on rencontre dans les climats plus civilisés ; car voyager, disait-il, c’est voyager dans une partie du monde aussi bien que dans une autre ; cela consistait à être quelque temps éloigné de chez soi et à franchir un certain nombre de lieues ; et il en appelait à l’expérience pour décider si nos voyageurs en France et en Italie ne prouvaient pas au retour qu’on eût pu les envoyer avec tout autant de profit en Norvège ou au Groenland. Conformément à ces résolutions de son père, le jeune homme s’embarqua et, en nombreuse et bonne compagnie, partit pour l’hémisphère américain. La durée exacte de son séjour est assez incertaine, mais sans doute fut-elle plus longue qu’il n’avait été prévu. Quoi qu’il en soit, cependant, nous n’en parlerons pas ici, toute l’histoire n’en contenant aucune aventure digne de l’attention du lecteur, car ce ne fut, en fait, qu’une scène continue de débauches, de beuveries et de déplacements d’un lieu à un autre. À dire vrai, nous avons tellement honte de la brièveté de ce chapitre, que nous aurions volontiers fait violence à notre histoire en y insérant une aventure ou deux de quelque autre voyageur, et nous avions emprunté à cette fin les journaux de plusieurs jeunes messieurs qui avaient récemment fait leur tour d’Europe ; mais, à notre grand chagrin, nous n’avons pu en extraire aucun incident suffisamment vigoureux pour justifier ce larcin devant notre conscience. En considérant la figure ridicule que doit faire ce chapitre, lequel ne représente pas moins que l’histoire de huit années, notre seule consolation est que celle des vies de certains hommes qui ont fait du bruit dans le monde, est en réalité une page aussi blanche que les voyages de notre héros. Aussi, comme nous offrirons par la suite une large compensation à cette inanité, nous passerons rapidement à des matières d’une importance véritable et d’une immense grandeur. Pour le moment, nous nous contenterons de déposer notre héros là où nous l’avions pris, après avoir informé le lecteur qu’il était parti pour l’étranger où il était resté sept ans avant de rentrer dans son pays.
Henry Fielding (1707-1754)
Vie de feu M. Jonathan Wild le Grand (1743)
traduction de Francis Ledoux
mercredi 15 avril 2009
Aller au diable par un chemin à soi
“Dieu me damne, monsieur Barry, vous n’avez pas plus de manières qu’un barbier, et je crois que mon nègre a été mieux élevé que vous ; mais vous avez de l’originalité et du nerf, et vous me plaisez, jeune homme, parce que vous paraissez déterminé à aller au diable par un chemin à vous.”
Thackeray, Barry Lyndon
chapitre XIII : Je continue mon métier d’homme à la mode
mercredi 8 avril 2009
Syntaxe et surtaxe
[Les Salander écrivent à leur fille, Setti ; ils viennent d’apprendre que son mari est en prison.]
 « Il prit donc une formule imprimée, la remplit comme il convenait de quelques mots laconiques et la donna à sa femme.
Elle lut le télégramme, l’examina un instant, puis remplit une nouvelle formule. Quand elle eut fini, Martin Salander lut à son tour le texte et s’étonna. Elle avait relié verbes et substantifs, alignés comme de rudes blocs de pierre, par les mots-outils nécessaires, mais sans rien modifier d’autre.
“Tu n’as rien ajouté du tout, sinon les pronoms, les articles et quelques prépositions. Le télégramme coûtera seulement deux fois plus cher !” dit-il, toujours étonné.
“Je le sais bien, c’est peut-être sot de ma part”, expliqua-t-elle humblement, “mais il me semble que ces petits ajouts adoucissent le ton, mettent un peu de coton autour des mots, de sorte que Setti aura l’impression de nous entendre parler et pour moi cela vaut bien une surtaxe. Mais si tu veux, c’est moi qui signerai.”
“C’est étonnant comme tu as raison !” dit Salander après avoir relu les trois ou quatre lignes. “En un clin d’œil le texte prend une tournure élégante et cordiale. Où diable vas-tu prendre ces procédés de style si merveilleusement simples ? Non, il faut que tu signes toi-même. Moi, vieux pédant que je suis, je n’en aurais pas eu l’idée !” »
« Il prit donc une formule imprimée, la remplit comme il convenait de quelques mots laconiques et la donna à sa femme.
Elle lut le télégramme, l’examina un instant, puis remplit une nouvelle formule. Quand elle eut fini, Martin Salander lut à son tour le texte et s’étonna. Elle avait relié verbes et substantifs, alignés comme de rudes blocs de pierre, par les mots-outils nécessaires, mais sans rien modifier d’autre.
“Tu n’as rien ajouté du tout, sinon les pronoms, les articles et quelques prépositions. Le télégramme coûtera seulement deux fois plus cher !” dit-il, toujours étonné.
“Je le sais bien, c’est peut-être sot de ma part”, expliqua-t-elle humblement, “mais il me semble que ces petits ajouts adoucissent le ton, mettent un peu de coton autour des mots, de sorte que Setti aura l’impression de nous entendre parler et pour moi cela vaut bien une surtaxe. Mais si tu veux, c’est moi qui signerai.”
“C’est étonnant comme tu as raison !” dit Salander après avoir relu les trois ou quatre lignes. “En un clin d’œil le texte prend une tournure élégante et cordiale. Où diable vas-tu prendre ces procédés de style si merveilleusement simples ? Non, il faut que tu signes toi-même. Moi, vieux pédant que je suis, je n’en aurais pas eu l’idée !” » Gottfried Keller, Martin Salander, p. 243-244
jeudi 2 avril 2009
Éponger la vie
« La société, ce qu’on appelle le monde, n’est que la lutte de mille petits intérêts opposés, une lutte éternelle de toutes les vanités qui se croisent, se choquent, tour à tour blessées, humiliées l’une par l’autre, qui expient le lendemain, dans le dégoût d’une défaite, le triomphe de la veille. Vivre solitaire, ne point être froissé dans ce choc misérable, où l’on attire un instant les yeux pour être écrasé l’instant d’après, c’est ce qu’on appelle n’être rien, n’avoir pas d’existence. Pauvre humanité ! »
« Quand on veut plaire dans le monde, il faut se résoudre à se laisser apprendre beaucoup de choses qu’on sait par des gens qui les ignorent. Il est aisé de réduire à des termes simples la valeur précise de la célébrité : celui qui se fait connaître par quelque talent ou quelque vertu se dénonce à la bienveillance inactive de quelques honnêtes gens, et à l’active malveillance de tous les hommes malhonnêtes. Comptez les deux classes, et pesez les deux forces. »
« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri. »
« Les hommes qu’on ne connaît qu’à moitié, on ne les connaît pas ; les choses qu’on ne sait qu’aux trois quarts, on ne les sait pas du tout. Ces deux réflexions suffisent pour faire apprécier presque tous les discours qui se tiennent dans le monde. »
« Quand on a été bien tourmenté, bien fatigué par sa propre sensibilité, on s’aperçoit qu’il faut vivre au jour le jour, oublier beaucoup, enfin, éponger la vie à mesure qu’elle s’écoule. »
Chamfort (1740-1794), Maximes et pensées
Inscription à :
Articles (Atom)